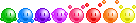TAKE A BITE OF THIS WORLD WHILE YOU CAN
Dans les vestiges du passé.
Emerald Kingdom, Elvendyr.
Reposant sur ce parterre fangeux et glacé, les omoplates adossées contre l’écorce rugueuse de ce grand arbre qui me tient assistance, imperturbable, j’observe la pureté du paysage. J’ai quitté les torrents tumultueux du royaume de Lazuli, me délaissant de ces rues usuellement achalandées pour aller me perdre au cœur de cette nature ombrageuse qui, à mes yeux, a toujours été mon sanctuaire. Assis aux pieds de cette vieille souche à moitié engloutie dans les entrailles de la terre frigorifiée par l’austérité de l’arrière-saison qui s’installe prématurément sur le territoire, je sonde, rêveusement, l’horizon embrasé qui se présente sereinement à mon regard. Mes grands yeux céruléens se perdent dans le contraste de la ligne embrunie qui se déploie énigmatiquement à perte de vue devant moi. Je suis encagé dans cette alcôve de pierre et de bois, alors que le reste du monde dégingandé semble paisiblement s’incliner à ma révérence. Je divague ici depuis plusieurs minutes, voire même un quart d’heure. Je vois le soleil déchoir lentement en arrière des innombrables montagnes, laissant nuancer des plaques d’ombres éphémères aux reflets moirés sur le sommet de ces géants colossaux. Franges disproportionnées qui se disputent en silence le droit de flamboyer une dernière fois durant le jour déclinant tandis que plus loin derrière, la riche frondaison oxydés se farde doucement pour enfin s’évanouir dans la nébulosité de la nuit. C’est la valse habituelle des ténèbres naissantes ! Spectacle que je me plaisais autrefois de regarder depuis cette vigie que je me suis improvisé.
Des mois se sont écoulés. Sept ans ont passés. Les semaines se sont égrainées dans les filets de l'espace-temps. Des longues et pénibles semaines où ma solitude est devenue ma plus fidèle alliée... ma meilleure amie. Cette présence intangible, cette force étonnante, qui m'aide à confronter avec peine le vide qui s'est sournoisement installé dans l'incohérence de mon mode de vie minablement chaotique et déjanté. 2555 jours, pour 354 semaines et 84 mois de nostalgie et d'isolement absolu. Durant 2555 jours, sa présence n'a jamais été qu'un souvenir. Un songe. Un triste et sombre songe. Un relent de nostalgie, pour un soupire de contrariété, un dégluti amer dans ma gorge obstruée par un noeud de plus en plus dense et oppressant. Une absence engendrant morosité et folie. Une absence beaucoup trop pressentie au sein d'un vide déjà beaucoup trop accaparant. Je m'accroches à cette présence invisible, comme je recherches vainement à m'accrocher à un vieux rêve illustre que je vois s'effriter dans le torrent paisible d'une tempête encore endormie, mais qui se réveille peu à peu de sa torpeur... pétrifiant dans son givre glacial, toutes ces parties de mon être disloqué que je ne cesses d'amputer avec cette barbarie cinglante et inhumaine. Je suis l'auteur de ma propre misère. Je le sais, mais je semble si peu m'en tracasser.
Gamin, je l’ai adorée comme un Mesquin. Adolescent, je l'ai méprisée comme un Révolté. Jeune homme, j’ai appris à l'aimer comme un Frère. Ma soeur me manque. Elle a indemnisé ma fureur. Elle a immortalisé ma frayeur. Elle a embourbé ma fadeur. Mais elle a ameuté ma froideur. Son empreinte a gagné demeure et engloutie mon coeur dans les plus infâmes torpeurs. Elle n'est jamais que chimère. Elle n'est jamais qu'éphémère. Elle n'est jamais que poussière. Elle n'est jamais que prière. Un murmure qui ne sait jamais se taire. Un murmure qui n'est jamais englouti sous la terre. Une rumeur accroissant ma peur. Une rumeur accroissant mes moeurs. Boire jusqu'à n'en plus rien voir. Boire jusqu'à n'en plus rien percevoir. Ivre de supplice. Ivre de mon plus redoutable vice. Ivre du bien. Ivre d'un rien. Vie de débauche. Vie où je me lèves inlassablement du pied gauche. Rien ne me suffit. Rien ne me satisfait. Comment profiter ? Comment apprécier ? Comment estimer ? Tant de questions, trop réponses. Boire jusqu'à n'en plus rien voir. Boire jusqu'à n'en plus rien percevoir. Gamin, je l'ai adorée comme un Mesquin. Adolescent, tu l'a méprisée comme un Révolté. Jeune homme, j’ai appris à l'aimer comme un frère. Des mois se sont écoulés. Un an a passé. Les semaines se sont égrainées dans les filets de l'espace-temps. Des longues et pénibles semaines où ma solitude est devenue ma plus fidèle alliée... ma meilleure amie. Cette présence intangible, cette force étonnante, qui m'aide à confronter avec peine le vide qui s'est sournoisement installé dans l'incohérence de mon mode de vie minablement chaotique et déjanté. 2555 jours, pour 354 semaines et 84 mois de nostalgie et d'isolement absolu. Durant 2555 jours, sa présence n'a jamais été qu'un souvenir. Et ma soeur te manque...
« Promets-moi, Lazar’. Promets le moi. Prends soin de moi. Prends soin de mon corps. Au moment venu, je ne saurai plus où il traîne. »
Je les laisses se réveiller. Doucement. Atrocement. Je les laisses lentement se réveiller. Ces douleurs vibrantes qui harponnent mon coeur comme une cible. Mon pauvre coeur qui se voit noircie par tant d'ecchymoses et de cicatrices. Ici, ma fêlure, je n'ai pas besoin de la cacher. Ces douleurs vibrantes, je n'ai pas besoin de les camoufler. Si creux engloutis dans cette dense et riche forêt, mon sanctuaire, ce masque, je peux le retirer de mon visage. Exprimer quelque chose. Laisser les lézardes sournoises se creuser peu à peu sur le satin de ma peau et affaisser mes traits de fer. Exprimer quelque chose. Je suis fini, terminé, brisé et détruit. Pour une seule fois, laisser la noblesse de ma tragédie lentement s'écouler sur le marbre de ma figure si austère, mais évidemment si moqueuse. Je n'a rien à craindre ou plutôt je n'ai personne qui doit me craindre. Pas ici. Pas dans cette forêt. Pas au sommet de cette gigantesque montagne. À part moi, là-haut, il n'y aucune âme qui y erre. Pour une seule fois, fermer les yeux et perçoir. Ressentir ce vide, mais ne pas l'engourdir avecmon tord-boyaux sacralisé. Je dois accepter et faire mon deuil. Je dois la libérer. Pleurer. Souffrir. Hurler. Déchirer la chair de mes jointures en allant démolir tout sur mon passage. J’ai pas besoin de gueule à casser pour ça. J’ai pas besoin de m'irriter. Ma tristesse, elle seule, peut parvenir si facilement à démolir ces barrages que j’ai pris une année de malheur à construire. Je lui ai promis. Voilà sept ans, déjà, que cette promesse est maintenue et je la retiens... mais elle doit s'en aller... elle doit s'envoler. La laisser partir. Ne pas la rendre martyre de mon délire. La Libérer. Je lui ai promis. Le temps est venu. Il est temps de lui dire au revoir. Il est temps de mettre définitivement fin à son désespoir.
Abandon que je ne supporte pas. Disparue sans explications. Arrachée à moi sans avoir le temps de lui dire au revoir. Et ce vide que je ne comprends pas. Dans mon crâne, il n'y a que cette promesse qui se répercute contre les parois. « Promets-moi, Lazar’. Promets le moi. Prends soin de moi. Prends soin de mon corps. Au moment venu, je ne saurai plus où il traîne. »
Péniblement, lourdement, je me redresse, mes jambes sont aussi molles que des spaghettis et alors que je me lève, un bruit mat et cristallin remonte lentement dans le silence mortuaire. Mes yeux, embrumés et écarlates d'ivresse, dérivent lentement vers la source, du coin de l'oeil, je vois la bouteille de whisky qui roule avec négligence sur le sol terreux et cahoteux. Ce même sol terreux et cahoteux que je sens tanguer sous mes pieds. J’suis saoul. Le liquide ambré égratigne ma gorge obstruée depuis plusieurs minutes. L'alcool commence à engourdir mes sens, dans mes veines, c'est comme si un magma incandescent se déverse et cette chaleur artificielle enveloppe mon être dans un étrange fourreau. Manteau de charme contre lequel j’ai pris l’habitude de m'y emmitoufler... pour fuir une réalité que je n'arrive toujours pas à croire... à comprendre. La douleur, ça fait tellement mal. J’ai beau y être acclimaté, je n'arrive pas à la cerner. C'est un mal qui écroue le corps de quelqu'un d'autre. Une partie de moi qui s'en est allée en même temps qu'Elle. Une souffrance lointaine qui pourtant persiste à torturer mon être. Je ne peux pas m’éviter de souffrir. Personne ne le peut. Et l'alcool n'est qu'un minable baume à cette vile blessure. J’ai toujours été là pour soutenir le monde et en retour le monde me soutient. Ce soir, pourquoi déraper ? Parce que à l'usure de feindre ce sourire mesquin, j’ai fini par en avoir mal aux lèvres et aux joues ? À l'usure de leurrer un bonheur artificiel, il m'a échappé ? En essayant de fuir, je me suis perdu. Je me suis perdu dans un endroit où, je sais, personne ne pourra jamais me retrouver. De la souffrance, je n'ai plus rien à apprendre. C'est pourquoi je cherche à la fuir. Ce soir, c'est plutôt la mort que je jalouse maladivement. Errant dans la forêt tel le si jeune vagabond que je suis, je la confronte. Je jalouse la mort, car c'est maintenant elle qui est capable de l'Apercevoir. Mes bras de fer bien repliés à l'effigie d'une croix contre mon torse massif, derrière cette étreinte persévéré, je recèles, contre ma poitrine, contre mon coeur, un secret. Une promesse. Elle est précieusement bien dissimulée entre les pans usés de ma veste en cuir, malhabilement, je marche au travers les roches et les racines qui éventrent la terre. Mes pas sont lourds, traînassant, je titube plus que je ne peux marcher, l'alcool me rendant marionnette de sa malice. Les yeux rivés sur l'horizon, sur ce merveilleux coucher de soleil, je me rapproche lentement de la lisière de la montagne et fais bientôt face au vide. Un pied calé sur une pierre, je me penche au-dessus de ces limbes et observes les immenses et vastes forêts qui s'étalent comme une mer fardée par les couleurs chaudes de l'automne. S'était sa saison préférée. Elle adorait voir tous ces arbres lentement se dégarnir de ces feuilles rouges et oranges tapissant la terre. Moi, j’ai toujours adoré l'hiver. J’aimais la glace et elle adorait le feu. J’aimais la vie et elle louangeait la renaissance. C'est l'hiver dans mon coeur mais c'est l'automne dans le sien. Deux contrastes. Les saisons ont beau meurtrir, refroidir et réchauffer cette planète, rien ne change. Rien ne changera. Je souris. Un triste sourire qui s'efface presque aussitôt. La vue de ces falaises escarpées, de ces immenses forêts, me rappelle, d'instinct, le rôle que je dois orchestrer ci-haut et malgré moi... je bouge. Je décrispe lentement les bras, extirpant le vase de ma veste en cuir et mes mains trapues retenant désormais l'urne sombre et métallique. Je retiens entre mes mains les vestiges d’Ophelia. Ma soeur. Jeune et belle Ophelia qui, autrefois, s'amusait à me dire tant de choses incongrues que je ne comprenais pas. J’étais trop jeune et naïf à cette époque. Et ma soeur m'a doucement bien ouvert les yeux. Malheureuse et triste Ophelia qui savait et voyait tant de choses. Ophelia qui plaisantait sur sa mort et sur cette quête de la liberté. Elle qui me disait que nous étions nés de poussières et que l’on envolera en poussières, au temps venu. Elle voyait ses cendres être portés par le vent, valsant dans le vide, sans jamais s'arrêter, pour qu'enfin elle puisse s'envoler. Elle qui se voyait en particules poudreuses, morcelées par l'univers, visitant le monde, dépassant les frontières, là-haut, dans les cieux. Elle disait être partout et nulle part à la fois. Libre. Tout simplement libre. Ailleurs. Elle voulait reposer dans les rivières, dans la terre, dans les arbres et dans les airs. Désormais, lorsque j’observe la Nature, c'est le visage d’Ophelia que je vois apparaître en mémoire. Doucement, j’avance sur le rocher, je suis au bord du précipice denté par les saillants récifs, seuls quelques centimètres me séparent du vide, mais je le défis sans peur et crainte. Je lève le vase devant moi, au niveau de ma poitrine, geste anodin qui pourtant me fend littéralement l'âme. Je l'ai déjà perdu une fois et ce soir j’ai l'impression de la perdre de nouveau.
Je soulève le couvercle et tends l'urne au bout de mes bras, au-dessus du vide. Les quelques premières poussières s'envolent craintivement, comme si la brise elle-même se refuse à elles. Constat dérisoire qui ne manque pas de me faire légèrement sourciller. Dans le tréfonds de mon être ravagé, une partie de moi hurle de refermer le vase, de le rabattre contre mon coeur et de rebrousser chemin... de retourner dans mon royaume et de remettre l'urne précieuse sur ma table de chevet. Son origine. Sa place initiale. Près de moi. Là où jamais je l'oublierai. L'endroit où les vestiges de mon propre sang et ma propre chair errent depuis voilà sept ans. Ma soeur est prisonnière dans ce vase depuis sept ans. Servile victime lors de son vivant. Esclave d'une Peur qui aura finalement eu raison d'elle. Embellir sa mémoire. Je sais ses volontés. Sa vie a été incomprise et gâchée. Ne pas entacher son repos et son âme. La libérer. Accepter ses volontés. Accepter mon deuil. Mon coeur et mon crâne sont en conflit. Tétanisé vers le précipice, c'est la force de la Nature elle-même qui allège mon esprit taraudé entre ma peur et ma peine. Le vent se lève et le tourbillon de cendre s'extirpe alors frileusement de ce minuscule tombeau mortuaire. Dans une beauté quasi déconcertante, je vois les particules valser paisiblement dans l'air, esquissant des spirales gracieuses et mystiques. Devant mes yeux émerveillés, l'arabesque mystérieuse de poussières m'offre durant quelques instants ses prouesses, étalant son écriture énigmatique dans la brise agitée qui l'aspire presque aussitôt et l'accompagne vers l'horizon oxydé. Vers le firmament orangé et pourpre. Par-delà les falaises, si haute au-dessus des éminences, elle s'envole... elle plane dans l'horizon, danse vers l'astre de feu incandescent qui lutte en silence son droit de faire briller ses rayons rutilants dans les cieux, avant qu'il ne soit englouti dans la terre. C'est comme si le soleil lui-même s'entête à ne pas vouloir tirer sa révérence, brillant au loin par-delà ces frontières, flamboyant pour une dernière fois, pour être le phare céleste qui guide et éclaire le chemin qu'est en train de se calfeutrer ma soeur dans le ciel cramoisie et de plus en plus sombre. Bouger dans l'espace, mais pas dans le temps. Les vestiges de ma soeur dansent, valsent au loin, magnétisés par ce lambeau d'espoir et de chaleur. Le soleil plonge lentement derrière les monts, les cieux se ternissent et s'assombrissent. Dans une beauté quasi déconcertante, je vois les particules valser paisiblement dans l'air, esquissant des spirales gracieuses et mystiques. Devant mes yeux émerveillés, l'arabesque mystérieuse de cendres t'offre durant quelques instants ses prouesses, étalant son écriture énigmatique dans le vent, pour aller se perdre et disparaître dans la pureté du paysage.
Ce sont les derniers mots d'adieux d’Ophelia. Elle n'avait que dix-sept ans. Elle ne connaissait de la vie que l'horreur, la peur, le désespoir et la mort. Maux qui à jamais ne sont parvenus à trouver baume. Plaies empourprées qui ne se sont jamais cicatrisées. Moi, j’étais trop jeune pour comprendre. Je voyais en la vie tant d'espoir et de possibilité. J’étais naïf et pur. Je n’étais un enfant. Je ne pouvais savoir ce qui allait arriver. Je l'ai vue s'enrouler cette corde autour de son cou, collier mortuaire lui écrasant les vertèbres... et avant que ses pieds dénudés se déracinent de cette chaise en bois, elle m'a murmuré ces phrases. « Promets-moi, Lazar’. Promets le moi. Prends soin de moi. Prends soin de mon corps. Au moment venu, je ne saurai plus où il traîne. »
Je voyais en la vie tant d'espoir et de possibilité. J’étais naïf et pur. J’étais un enfant. Mais la barbarie et la cruauté de ce monde ont commencé à lacérer mon coeur et à engloutir mon être vers les ténèbres. En de longs hoquets d'étouffement, elle s'est éteinte, là, sous mes yeux, son corps inerte ballotant mollement dans le vide. Je pensais que s'était une blague. Mais les sanglots meurtris de ma mère retentissant en trombe dans la chambre m'ont fait comprendre que ça en n'était pas une. Ma soeur s'en est allée. Je me suis perdu. Écroué dans les maillons de cette chaîne servile qui s'enroule autour de mes membres et me manient comme un pantin. L'univers lui-même me semble n'être qu'une gueule à jamais rassasiée. Un gouffre sans fond qui a toujours soif. Aspirant des âmes fêlées pour alléger ces envies bestiales et fauves. Le royaume de l’onyx, les ombres, ils ne sont que des crocs acérés et saillants que je parviens à entrevoir par-delà cette gueule sinistre et sépulcral qui s'étend à perte de vue devant mes yeux qui commencent à peine à voir le monde tel que ma soeur le voyait, jadis : Les griffes dans la viande, les crocs affutés enfoncés dans la chair. Le démon grogne... hurle avec appétit et mangent nos carcasses avec voracité. Ce soir, je la libère. Je la délivre de cette gueule monstrueuse et la regarde s'envoler.
Les gens la disaient folle. La gens la croyaient dépressive. Ils avaient peut-être raison. Je n'en sais rien et je ne veux pas savoir. Des larmes pures et cristallines perlent et dansent sur m es cilles, dans le coin de mes yeux... mes yeux qui se camouflent avec hâte derrière mes paupières qui embrassent lourdement l'obscurité. Les larmes meurent dans mes yeux. Pleurer... j’en suis plus capable. Le vent se réveil et souffle à mes oreilles. C'est la mélodie du temps qui passe et trépasse.
Gamin, je l'ai adorée comme un Mesquin. Adolescent, je l'ai méprisée comme un Révolté. Jeune homme, j’ai appris à l'aimer comme un Frère. Et comme un frère je vais apprendre à l'aimer comme un homme. J’ai dix-sept ans. Je ne connais de la vie que l'horreur, la peur, le désespoir et la mort. Mes grands yeux océans sont désormais devenus que deux abîmes éprouvés dans les ténèbres, qui bientôt aspireront toutes mes larmes. Je projettes ce regard plein de résolution et de colère sur ce monde qui me tourmente et me gruge. J’ose lancer ce regard... sur ce chaos... fruit de la désespérance. Univers qui n'est rien et à la fois tout. Monde engendré de chimère et néant. Un mensonge.
J’ai mal. Mal au coeur. Mal au crâne. Mal à la peau. Mal à l'âme. Mal de vivre en un monde si vain. Mes mains se replient à l'effigie de poings dangereusement contractés. Je ne me sens pas bien. Durant un temps, je ne vais pas aller mieux. Mais je vais vivres. Je vais survivre. Je vais grandir. Je vais survivre pour vivre. Et enfin... peut-être... je serai libre. Libre de pleurer. Libre de crier. Libre de changer les choses. Libre de museler cette gueule monstrueuse !
Je m’appelle Lazarus, ce prénom, très bientôt, il sera craint et prononcé au travers de tant de lèvres, tant de souffles et tant de murmures.
De cendres et de poussières, ma soeur s'est envolée. De cendres et de poussières, Ophelia est ainsi donc devenue. Et sans plus m'attarder, je pivote lentement sur les talons, laisse s'enfuir derrière-moi, ce relent amer de nostalgie.
-
On se retrouvera bientôt, ‘Lia. Je t'aime.La guerre est officiellement déclarée !











 Je suis vraiment trop content de voir débarquer Tom Payne sur le forum sérieux
Je suis vraiment trop content de voir débarquer Tom Payne sur le forum sérieux  C'est un choix d'avatar de malade ! Je ne l'ai d'ailleurs jamais croisé jusqu'à présent alors j'adhère et j'adore
C'est un choix d'avatar de malade ! Je ne l'ai d'ailleurs jamais croisé jusqu'à présent alors j'adhère et j'adore  J'aime déjà vraiment tout ce que tu nous as écrit dans les informations de ton personnage
J'aime déjà vraiment tout ce que tu nous as écrit dans les informations de ton personnage  Vraiment, tu sors des sentiers battus et j'adore déjà ton humour
Vraiment, tu sors des sentiers battus et j'adore déjà ton humour  et le pouvoir des membres détachables
et le pouvoir des membres détachables  J'adoreeeeee que ce pouvoir soit pris
J'adoreeeeee que ce pouvoir soit pris  (Je vais justement voir Godsmack et Volbeat à Ottawa en mai
(Je vais justement voir Godsmack et Volbeat à Ottawa en mai  )
)
 j’ai tellement hâte de lire ta fichette!!
j’ai tellement hâte de lire ta fichette!!

 tu m’as eu en beauté!!
tu m’as eu en beauté!!  Et merci beaucoup pour le petit mot de bienvenue ! Trop hâte de peaufiner lien avec toi
Et merci beaucoup pour le petit mot de bienvenue ! Trop hâte de peaufiner lien avec toi